L'eau était répartie en 1864 de la manière suivante
:
1) 1er étage de la chute : Il y avait un partage de cette eau entre
3 roues à augets :
· La première roue avait un diamètre de 3 à 4
mètres et une couronne de 80 cm de largeur, elle servait à faire
fonctionner le bocard à sec de la criblerie.
· La deuxième roue et la troisième, toutes deux avaient
un diamètre de 3 à 4 mètres sur une largeur de 80 cm
; elles servaient à faire fonctionner les 6 tables
à secousses qui étaient comprises dans les laveries n°1
et n°2.
2) 2ème étage : la distribution des eaux, qui avaient été
à nouveau réunies, se faisait de la façon suivante :
· toute l'eau servait à actionner 2 bocards de 4 batteries à
4 pilons qui servaient aux ateliers n°1 et 3.
Ces bocards étaient mis en action grâce à une roue de
4 à 5 mètres de diamètre ayant une largeur d'un mètre.
Le bocard est un instrument qui est mû par la force
hydraulique. 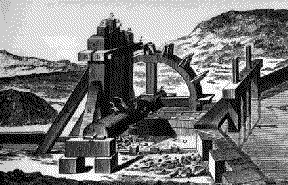
Le courant entraîne une roue ; sur cette roue est fixé
un axe, sur cet axe sont fixés des cames qui soulèvent des pilons
qui, en retombant, concassent le minerai brut. Les pilons mesurent 5 à
10 mètres de haut, ils sont en bois mais équipés d'un
sabot métallique en forme de dents dans leurs parties inférieures.
Les pilons retombent alternativement sur le minerai. Le minerai brut est entraîné
par le courant d'eau sous les pilons. Le passage du minerai dans le bocard
permet de concasser le minerai. Le bocard permettait de concasser la crasse
et donc de récupérer le métal.
3) A la sortie des roues, les eaux passaient sur la rive droite du ruisseau
de La Picadière, actionnant au passage une roue à aubes courbes
qui soulevait 3 à 4 flèches d'un bocard à sec, utilisé
pour le broyage des terres de brasque et de coupelle.
4) Enfin, en se rendant au Luech, les eaux faisaient tourner 2 roues à
augets :
· L'une avait 5 m de diamètre sur une largeur de 80 cm, elle
servait à l'atelier du bocard n°2, qui avait 3 batteries de 5 flèches.
· L'autre avait un diamètre de 5 m et une largeur de 80 cm,
elle servait à actionner la soufflerie et la fonderie.
L'usine a été construite en 1797.
Elle comprenait :
· L'atelier avec :
- 5 bocards de 58 flèches
- 12 tables à secousses et 80 bassins
de dépôts.
- 12 cribles à main
- 2 grands trommels
- 1 appareil anglais pour le débourrage
- 1 table tournante avec 4 bassins de dépôts
· L'atelier de fonderie avec :
- 1 bocard armé de 6 flèches pour la pulvérisation des
terres et des brasques servant à la réalisation des creusets.
- 2 fourneaux à manche
- 3 fours de grillage
- 1 four à coupelle
- 1 trommel pour le classement des litharges
- des chambres de condensation de 200 mètres de long pour les fumées.
En 1827 la fonderie de Villefort est transférée à Vialas
et l'on y installe le matériel suivant :
- 3 fours à réverbère pour le grillage du minerai
- 3 fours à manche pour la fonte
- 1 four à coupellation pour séparer l'argent du plomb.
- 1 four à raffinage pour l'argent
- 1 chaudière à vapeur qui actionne la soufflerie des fourneaux.

